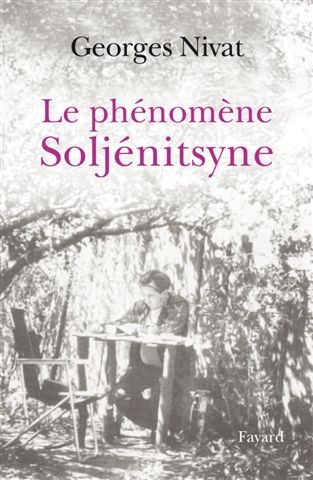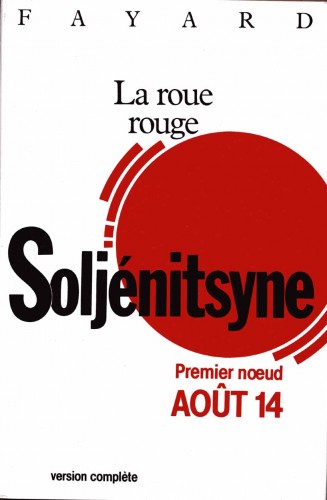"Tâchez de voir en moi le chrétien plutôt que le littérateur".
Lettre de Gogol à sa mère en 1844.
"Prie pour que mon labeur soit véritablement consciencieux pour je sois jugé digne de chanter un hymne à la Beauté céleste"
Lettre à son ami Joukovski, 1852
Nul mieux que le grand slavisant Pierre Pascal (1) n'a cerné de manière aussi aiguë ce qu'il appelle le "Drame spirituel de Nicolas Gogol". En 1952 il intitulait de la sorte une magnifique introduction à la traduction française des Méditations sur Divine liturgie (2). Il y soulignait l'incompréhension de la majorité des compatriotes et contemporains. Car, écrit-il : "les intellectuels russes de 1850 étaient encore trop les enfants du siècle des lumières pour voir dans les exigences religieuses de Gogol autre chose qu'une maladie mentale et dans sa fin un drame de la folie".
Dès sa dernière "Nouvelle Pétersbourgeoise" intitulée "Le Manteau", commencée à Vienne en 1841 Gogol préfigure, par la pauvre destinée d'Akaki Akakiévitch, la sienne propre : "Laissez-moi ! Pourquoi me faites-vous mal !... dès lors, tout fut changé pour lui... une force surnaturelle l'écarta des camarades... qu'il avait pris d'abord pour des gens convenables..."
Irrésistiblement aussi, on songe au serviteur souffrant. On se remémore également Celui qui est venu parmi les siens et que les siens n'ont pas reçu.
Une part essentielle d'un des plus grands écrivains russes reste aujourd'hui encore méconnue
Dans sa patrie même, on recommence à s'intéresser à lui, non pas seulement comme auteur des textes charmants ou satiriques, qui lui ont valu son immense renommée depuis les années 1830, mais aussi comme croyant.
Le site internet en langue française "Parlons orthodoxie" (3) indiquait à cet égard début avril que : "le hiéromoine Syméon Tomatchinski, directeur des éditions du monastère Sretensky à Moscou, est convaincu que l'œuvre de Nicolas Gogol renferme un grand potentiel missionnaire : elle aide l'homme contemporain à comprendre le sens des sacrements de l'Église. Il faut davantage éditer et faire connaître les œuvres de Gogol, considère le père Syméon, persuadé que Gogol est l'écrivain le plus religieux de la littérature russe, non seulement par sa vision des choses, mais aussi par son mode de vie. Parmi les œuvres spirituelles de Gogol, il accorde la place la plus importante aux Méditations sur la divine liturgie, "oubliées" pendant l'époque soviétique."(4)
Sur la tombe de l'écrivain, au cimetière du monastère Novodevitchi de Moscou après une pannykhide donnée pour le 200e anniversaire de la naissance de l'écrivain, le métropolite Juvénal, évêque de la région de Moscou soulignait pour sa part son "désir ardent de partager sa foi avec le monde, de lui transmettre sa vision de l'aspect mystique de notre existence. Il semble qu'il n'ait jamais été entendu (…). La portée véritable de sa quête spirituelle n'a pas encore été complètement comprise".
En Russie, en Ukraine et un peu partout dans le monde orthodoxe slave, nous viennent donc beaucoup d'éloges à son propos. Mais voici ce qu'on peut trouver dans le Wikipedia francophone au sujet d'une de ses œuvres spirituelles les plus importantes, les Passages choisis d'une correspondance avec des amis témoignage, dans la patrie de Descartes, de l'incompréhension qui demeure quand on lit ceci :
Cet ouvrage est présenté comme une suite de lettres écrites entre 1843 et 1846. Celles-ci touchent à des thèmes extrêmement variés : la littérature (Les Âmes mortes et leur véritable signification, en particulier), l'éducation des serfs par les propriétaires fonciers, les obligations des épouses de gouverneurs etc. Leur contenu est ultra-conservateur, voire obscurantiste. Elles ont le ton du prêche.
Aujourd'hui, les Passages choisis sont surtout un document essentiel pour comprendre le drame de Gogol : dépression, perte d'inspiration et dérive mystique. Depuis 1843, celui-ci n'avait plus rien publié. Voyageant frénétiquement à travers l'Europe de l'ouest, il emportait dans son bagage le manuscrit de la suite des Âmes mortes, son chef-d'œuvre, dont ses nombreux admirateurs attendaient impatiemment la finition. L'écriture, cependant, n'avançait pas. Gogol, déprimé et hypocondriaque, chercha secours dans la religion. C'est ainsi qu'il s'orienta vers un ultra-conservatisme moral et politique (adhésion fanatique à l'orthodoxie et à l'autocratie).
Les Passages choisis déclenchèrent un véritable "scandale Gogol" en Russie.(…)
Tout ceci surprit et bouleversa Gogol, qui croyait sincèrement à sa renaissance artistique. Il ne publia plus rien jusqu'à sa mort, en 1852.
Revenons à la réalité des écrits de Nicolas Vassiliévitch Gogol
Quand on souhaite évoquer l'œuvre ou la pensée d'un écrivain une première remarque s'impose. On se situe soi-même et on inscrit son auditoire dans un certain contexte, celui de la langue de ses interlocuteurs ou de ses lecteurs. Ignorant le russe, je n'accède à cette littérature, que j'aime et qui touche aux choses qui, en définitive, me préoccupent avant tout, qu'au gré de ses traductions françaises.
Dans la pratique on constatera, hélas, que la deuxième partie de ses œuvres complètes, exprimant sa pensée profonde ne reste guère disponible aujourd'hui, pour le lecteur francophone, que dans l'excellente mais coûteuse édition de la Pléiade de 1966.
On peut, et on doit, véritablement distinguer, sans les opposer, deux parties chronologiques dans les écrits de Gogol.
Or, la première, la plus connue, et surtout la plus reconnue, largement profane est abordée le plus souvent par bribes. On ne cherche à y voir aucune continuité, et surtout aucune idéologie. L'auteur de ces lignes peut en attester : entre la découverte émerveillée de "Taras Boulba" (1835), le premier "vrai" livre que quelqu'un lui ait offert, et la lecture des "Nouvelles Pétersbourgeoises" (1843), il s'est écoulé pour moi un bon demi-siècle.
Ces créations délicieuses et heureuses appartiennent au royaume des lettres. Elles semblent, à première vue, échapper à tout classement. Les étiquetages qu'un certain public de faux-lettrés a pu accoler à certains textes, les décrivant comme les plus contestataires, ainsi le "Revizor" (1836) ou, plus encore, les "Âmes mortes" (1842), relèvent surtout du malentendu. Et dès le début notre auteur a tenu à s'en excuser.
Pour comprendre "le Grand Dessein de Gogol"
Tout cela nous amène à évoquer la deuxième partie de son œuvre, celle qui sera qualifiée de "Grand Dessein de Gogol", et qui s'inscrit dans une démarche explicite d'apologie de la Foi orthodoxe.
Né en 1809, l'auteur dont on fête, hélas assez modestement le bicentenaire, est âgé de 36 ans quand il annonce publiquement en 1845 son "retour à la religion".
Que faut-il entendre par "retour à la religion" ?
Ce mot, cet événement et cette démarche appellent à leur tour des éclaircissements. Essayons de ne pas trop nous encombrer de pédantisme ou d'étymologie pour évoquer le fait que dès les auteurs latins, dont la langue française est issue, le terme religio peut s'interpréter dans des sens bien différents. Chez Cicéron, il signifie "le respect que ressent l'individu au plus profond de lui devant tout être qui en est digne, divin en particulier". Pour toute une lignée d'auteurs chrétiens estimables, comme Tertullien, Lactance et jusqu'à Chateaubriand ce fait est supposé "religere", relier, réunir les hommes.
Or tout cela s'inscrit dans une tradition latine et catholique. Et on ne peut ignorer que celle-ci diffère de la pensée orthodoxe, tributaire elle-même de la transposition en langue grecque d'idées hébraïques.
Pour l'orthodoxie chrétienne, le mot "religion" doit être considéré comme ambigu, pour ne pas dire : trompeur. À proprement parler le christianisme ne relève pas du "phénomène religieux".
Il existe plusieurs concepts, fort différents :
- la "foi", adhésion volontaire et individuelle. La phrase récurrente de Jésus consiste à dire aux miraculés "ta foi t'a sauvé" ;
-et le "culte", dont les ministres forment le clergé et ne constituent aucunement à eux seuls "l'Église" ;
- à distinguer lui-même des "œuvres".
Ceci lève la fameuse ambiguïté sur laquelle a buté le "sola fide" de Luther. L'interprétation protestante traditionnelle devient, dans son expression extrême, irrecevable pour un orthodoxe en raison même de l'argument développé dans l'épître de Jacques. Que signifierait, en effet, la "foi sans les œuvres" ? La réponse néo-testamentaire fuse alors comme une évidence : "la foi sans les œuvres est une foi morte" (Jacques 2, 17).
La dérive symétrique, celle d'un certain "activisme occidental", a été chantée par l'excellent philosophe [catholique] Philippe Nemo dans son petit livre "Qu'est-ce que l'occident ?"(5). L'auteur y développe l'éloge de ce qu'il appelle la "révolution papale du XIIe siècle". Ainsi nomme-t-il la "réforme de Grégoire VII" après sa victoire sur Henri IV de Hohenstaufen (1077). Cette lutte de la Papauté contre l'Empire occidental se prolonge jusqu'à la mort de Frédéric II (1250). Pour faire court, et résumer honnêtement le propos, "il ne suffit pas de prier il faut transformer le monde". Tout lecteur de l'Évangile (Mt 4,1-11 ; Mc 1, 12-13 ; Lc 4,1-13) reconnaît les trois tentations du Christ, et particulièrement la première : "transformer les pierres en pain", objectif économique qui guette toutes les tentatives de "doctrines sociales".
Sans aucune ambiguïté, cette formulation "occidentaliste" se veut commune au catholicisme et au protestantisme. (6)
Et elle s'affirme également éloignée de l'orthodoxie.
Elle reprochera donc à cette dernière son "essence conservatrice". Philippe Nemo ne s'abstient pas de le faire explicitement dans son livre : il s'agit de prétendre que l'orient chrétien cantonne la "religion" à la prière. Pour enfoncer le clou, le même brillant apologiste croit bon d'interpréter dans ce sens, à notre avis biaisé, la fameuse Légende du Grand Inquisiteur. Ce passage essentiel des "Frères Karamazov" marquerait de la sorte, et entacherait du sceau de l'obscurantisme "oriental", la foi de Dostoïevski.
On va voir que nous en arrivons là, très précisément, à l'occultation de sa pensée qui sera infligée à Gogol.
Son cercle d'amis et son influence
Globalement incompris, dans les dix dernières années de sa vie, il fit cependant quelques adeptes, et non des moindres.
En 1843-1844 il séjourne à Nice et réunit un petit nombre d'amis. Au nombre de ceux-ci il convient de citer la comtesse Vielgorski et ses deux filles, la comtesse Sophie Solloghoub et Anna Mikhaïlovna "la seule femme dont Gogol ait été amoureux" (7). Ce groupe compte aussi Mme Smirnova, sa protectrice qui est aussi la dame d'honneur de l'Impératrice ainsi que les deux poètes Yazhykhov et Joukovsky.
Plus tard, il n'hésitera pas à donner à ses amis des conseils spirituels. On ne les trouvera pas anodins dans le contexte de sa conception discrète et personnelle de l'orthodoxie : "prends aussi cette habitude : chaque samedi fais célébrer chez toi la vigile nocturne".
Beaucoup plus tard, en 1888 Tolstoï publiera, sous pseudonyme, une brochure "N.V. Gogol comme maître de vie".
Pierre Pascal s'interroge à ce sujet, dans les termes suivants : "Pourquoi Tolstoï, négateur de l'Église et de l'État a-t-il tant aimé Gogol orthodoxe et conservateur ? N'est-ce pas qu'il reconnaissait en lui un premier interprète de sa pensée la plus profonde : pénétrer de christianisme la vie intellectuelle et sociale toute entière ?"
Ce n'est qu'en 1850 qu'il fait un pèlerinage à l'ermitage d'Optina où il s'entretiendra avec le starets Macaire.
Sa vision du salut de la société
Il commence à la développer dans les "Passages choisis" de la correspondance avec ses amis.
"Ma cause, écrit-il pour les présenter, est celle de la vérité et du bien public". Ses textes sont qualifiés, par leur auteur de "nécessaires et utiles". Ils "apportent le salut" et répondent à une situation de la Russie qu'il affirme "malade". Or le pays ne sortira de cette maladie que si :
"à la place qui lui a été assignée par Dieu, chaque Russe, tsar, haut fonctionnaire, propriétaire foncier, serf, artiste, écrivain, femme du monde, femme de gouverneur, etc. se décide à servir"…
Dans un autre texte ("Confession d'un auteur) il posera ce choix comme la découverte du véritable sens de l'existence humaine : "Notre vie tout entière est service". Cette notion, d'ailleurs, remonte aux racines mêmes de son œuvre. Dès 1829 son désir un peu naïf d'être un grand homme, il le définit "pour le bien de sa patrie et le bonheur de ses semblables".
On peut devenir meilleur en suivant les enseignements de l'Église et l'on peut contribuer à rendre les autres meilleurs en exerçant une bonne influence. Tout cela suppose de "faire entrer le Christ dans les moindres actions de sa vie".
On doit noter que Gogol refuse très explicitement, ou pour parler de manière plus exacte, il se désintéresse absolument de l'idée de changer la moindre institution, y compris le servage. Nous serions tenté de résumer de la sorte la vision sociale de Gogol en la définissant du point de vue orthodoxe : Le christianisme ne vise pas la transformation du monde par la loi, mais à sa transfiguration par la foi.
L'exemple de la cruelle institution du servage qu'Alexandre II abolira en 1861…
Le point ne peut pas être pudiquement mis de côté puisqu'il s'agit du sujet même des "Âmes mortes".
Évoquons donc ici quelques données à propos de cette forme sociale. On la considère aujourd'hui, peut-être à juste titre comme la marque, la plus odieuse, d'une injustice toute médiévale et de l'obscurantisme. Elle se distingue radicalement de l'esclavage, en ce sens que le serf y dispose d'un statut social de personne humaine. Le système était apparu dans l'occident médiéval et a évolué au gré des siècles et des pays. En Angleterre, il fut aboli dès XVIe siècle, mais en Écosse seulement au XVIIIe. En France, il avait pratiquement disparu à la veille de 1789.
Dans le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie, le statut des "serfs-paysans" s'était dégradé au cours des âges. Sur les domaines seigneuriaux, le nombre de jours de servage est passé, on n'arrête pas le progrès : de quelques jours dans l'année XIIIe siècle, à 1 jour par semaine au XIVe siècle, 4 jours par semaine au XVIIe siècle et de 6 au XVIIIe. Et comme le septième jour était consacré au repos, le "serf-paysan" polonais ne pouvait plus cultiver son lopin personnel.
En Russie, au contraire, le servage n'a été généralisé que sous l'effet de l'occidentalisation, à partir du XVIIe siècle. Il sera largement aggravé au temps des "Lumières". Le 19 février 1861 l'abolition de ce "contrat" par le tsar Alexandre II libère de manière radicale 40 % de la population.
Dans la perspective chrétienne qui est la sienne on ne peut évidemment pas dire, de Nicolas Vassiliévitch Gogol, qu'il "défend" le servage. Son livre "les Âmes mortes" est généralement considéré comme la plus admirable dénonciation de cette sinistre institution : mais il s'écarte de toute apologie de la révolte.
Sommes-nous autorisés à dire ici que l'Histoire lui donna raison : moins de 20 ans après son livre, par la volonté d'un monarque libérateur, que les révolutionnaires assassineront, le système disparaît. En revanche après 1921, et la victoire des Rouges, des "justes révoltés", pendant la guerre civile, la condition des travailleurs de la glorieuse Union Soviétique évoluera rapidement vers une forme d'esclavage que l'ancienne Russie n'avait jamais connue, et qui ne disparaîtra qu'après 70 ans de souffrance et d'oppression.
La question de la censure administrative
Vers 1847 il se trouve confronté à la fois au problème de la censure et à son éreintement propre par la presse, de même qu'aux reproches véhéments de certains membres du clergé. Il mobilise un petit comité de lecture de 5 personnes.
Il prend pour modèle Karamzine (1766-1826) précurseur du mouvement slavophile. En 1811, celui-ci avait publié une "Note sur l'ancienne et la nouvelle Russie". L'auteur se verra attaqué comme glorifiant l'autocratie. Mais il subit en fait la censure parce qu'il critique les anciens empereurs modernistes. Le même publiera en 1818 un pamphlet intitulé "L'opinion d'un citoyen russe" où il critique l'autonomie accordée à la Pologne.
Voici ce qu'écrit Gogol à ce sujet : "Karamzine a été le premier à nous montrer qu'un écrivain peut chez nous être honoré et indépendant à l'égal du plus titré des citoyens. Le premier, il a proclamé solennellement que la censure ne saurait gêner un écrivain et que si, l'écrivain est animé du plus pur désir de faire le bien, au point que ce désir, s'emparant de toute son âme, devienne sa chair et sa nourriture, alors aucune censure ne lui est sévère et il est à l’aise partout. Karamzine a dit cela et il l'a prouvé." (8)
"Comme ils sont ridicules après cela, ceux d'entre nous qui prétendent qu'en Russie il est impossible de dire la vérité pleine et entière et qu'elle ne peut que blesser ! (...) Allons donc !", conclut-il. "Ayez une âme aussi pure aussi bien ordonnée que Karamzine, et alors proclamez votre vérité !" (9)
Ceci entraînera à son encontre les foudres du pire inquisiteur des lettres russes, censeur politiquement correct, plus dur encore que son homologue administrative de l'époque, précurseur lui-même du réalisme socialiste, le pense-petit Bielinski qui ose écrire : "les hymnes aux puissances du jour arrangent parfaitement la situation terrestre du pieux auteur".
Certains textes ne pourront paraître qu'après sa mort en 1857 : "Confession d'un auteur" et son travail par les archives de l'Académie de Kiev, que Gogol a recopié des extraits de 17 Pères de l'Église et de 10 théologiens russes des XVIIe et XVIIIe siècles. Il se faisait traduire du grec en latin notamment saint Jean Chrysostome et saint Basile le Grand.
Slavophiles contre occidentalistes
Comme toujours on doit se méfier des classifications réductrices. Dans sa Lettre XI "Controverses" on pourrait même penser de notre auteur qu'il entend se tenir à égale distance des "deux camps" slavophiles et occidentalistes qui apparaissent vers 1839-1840. Les occidentalistes ("rapadnicki") Herzen, Botkine, Bielinski attendaient, au départ, des principes politiques de l'occident la transformation du régime absolutiste. Les "slavophiles" proprement dits sont représentés par IP Kirievski (1806-1856) et Khomiakov (1804-1860). Leur pensée consiste à dénoncer d'abord deux grands maux de la Russie : les réformes de Pierre le Grand, et l'asservissement de l'Église russe à l'État.
En 1844-1845 on assiste à la rupture totale entre les deux milieux. Et c'est à ce moment que, par ailleurs, se situe la conversion, le retour à la foi de Gogol. On verra qu'à tous égards ou presque ses idées rejoignent celles des slavophiles. On remarquera que lui-même utilise des mots différents comme "vostokchnicki" opposé à "zapadnicki". Vostok c'est l'orient "slavianofily" finira par s'imposer un peu plus tard.
Sa conversion
En 1842, Gogol quitte à nouveau la Russie. Il entend alors écrire la deuxième partie de ses "Âmes mortes", aujourd'hui encore célébrissimes quoique largement incomprises et qu'on a si longtemps présenté comme une sorte de pamphlet social. Ses biographes honnêtes considèrent que cet événement essentiel de son cheminement va lui donner ce que la prière liturgique orthodoxe nous apprend à demander au Seigneur : une fin de vie chrétienne.
À partir de 1843, il se veut avant tout chrétien. Il "a pris", dès lors, note Pierre Pascal, "la religion au sérieux".
En 1838 au cours de sa première découverte de l'Italie qui ne constitue alors, a-t-on dit, qu'une expression géographique, il note déjà : "À Rome seulement, on prie, ailleurs on fait seulement semblant". C'est aussi dans la Ville Éternelle que semble se situer une conversion, probablement amorcée aussi par un épisode de 1839, où meurt dans ses bras son ami Joseph Wielgorski, alors que lui-même souffre de maladie et pourra écrire "je sens déjà l'odeur de la tombe".
On ne saurait contester que, redécouvrant la religion à Rome, il ait été attiré par le catholicisme. Quoiqu'il s'en défende, il écrira néanmoins qu'il juge les "religions catholiques et orthodoxes également vraies".
Son chemin mystique se précisera et se développera plus tard, avec les années. En 1844 il découvre la Philocalie. Par la suite il rencontrera les représentants de cette spiritualité cette spiritualité hésychaste sans la connaissance de laquelle on ne peut rien comprendre véritablement à la spécificité du monde orthodoxe.
Si critiquée ait-elle été, sa correspondance, éclaire donc bel et bien la précision de sa pensée, son grand dessein.
Voilà encore ce qu'il écrit :
"Personne ne sera sauvé s'il n'aime Dieu, et cet amour n'existe pas chez nous. Ce n'est pas dans un couvent que vous le trouverez, n'y vont que ceux que Dieu lui-même a appelés".
(…) "Mais comment aimer ses frères, comment aimer les hommes, l'âme ne veut aimer que le beau et les pauvres hommes sont si imparfaits, il y a en eux si peu de beau ! Comment donc y arriver ? Remerciez Dieu avant tout d'être Russe." (10)
Cela met évidemment en perspective toutes les considérations douloureuses qu'il a pu rencontrer ou formuler lui-même, celles que les âmes pures, en tout temps ou en tout lieu, sont tentées de ruminer, sur l'état de la patrie.
Et enfin cet esprit en marche nous lègue ce viatique :
"Pour un chrétien les études ne sont jamais terminées ; le chrétien est un élève perpétuel, jusqu'à la tombe". (11)
Apostilles
- né en 1890 et mort en 1983 ce grand défenseur de la culture russe n'aura jamais connue la fin de l'Union soviétique.
- 118 pages, Bruges-Paris 1952, éditions Desclée De Brouwer.
- créé par le diocèse français du patriarcat de Moscou
- Après vérification, nous pensons cependant que le P. Syméon se trompe quand il écrit : "Pour écrire ces Méditations, Gogol avait même appris la langue grecque." Au contraire il s'était fait traduire les textes des Pères grecs en latin.
- publié en 2004 au PUF et qui a rencontré un succès certain puisque réédité en 2005
- et ceci contrairement à la fameuse thèse de Max Weber
- au témoignage du beau-frère de celle-ci, le comte Sollogoub cf. Œuvres complètes Pléiade page 1867/note de la page 1390
- cf. Œuvres complètes Pléiade Lettre XIII p. 1552
- ibid. page 1553
- cf. Œuvres complètes Pléiade Lettres XIX et XX "il faut aimer la Russie" page 1591 et "il faut voyager à travers la Russie".
- cf. Œuvres complètes Pléiade Lettre XII "Le chrétien progresse" p. 1549.
JG Malliarakis





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
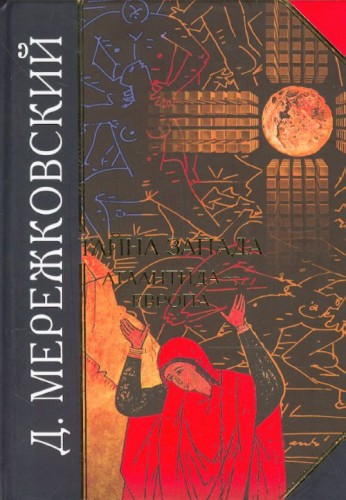 Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.
Gli attacchi giapponesi alla flotta Russa di Porth Arthur nel febbraio 1904 assediarono la città ed inflissero una severa sconfitta all'esercito russo in battaglie gigantesche e spietate coinvolgenti più di 500.000 soldati ed annunciando i combattimenti di trincea della prima guerra mondiale. Porth Arthur divenne giapponese nel gennaio 1905 e la notizia della sua caduta scosse la Russia. I successi militari fornirono la giustificazione all'autocrazia dello Zar. Nel gennaio 1905, una folla di 200.000 persone si avvicinò al Palazzo di San Pietroburgo per portare una petizione allo zar. Fu crudelmente colpita dalle guardie, lasciando centinaia di morti e proruppe la via delle proteste e degli scioperi. La liberazione della Russia si ebbe con lo scoppio di una guerra contro il Giappone che attraversò metà del globo dal Mar Baltico al Mar di Giappone e per una controffensiva, fu affondata la flotta russa dall'armata navale giapponese nel maggio 1915, vicino all'isola di Tsushima.